Publié le 29 avril 2025 Dans Actualité scientifique
Actualité scientifique | Arrimer les infrastructures aux risques climatiques
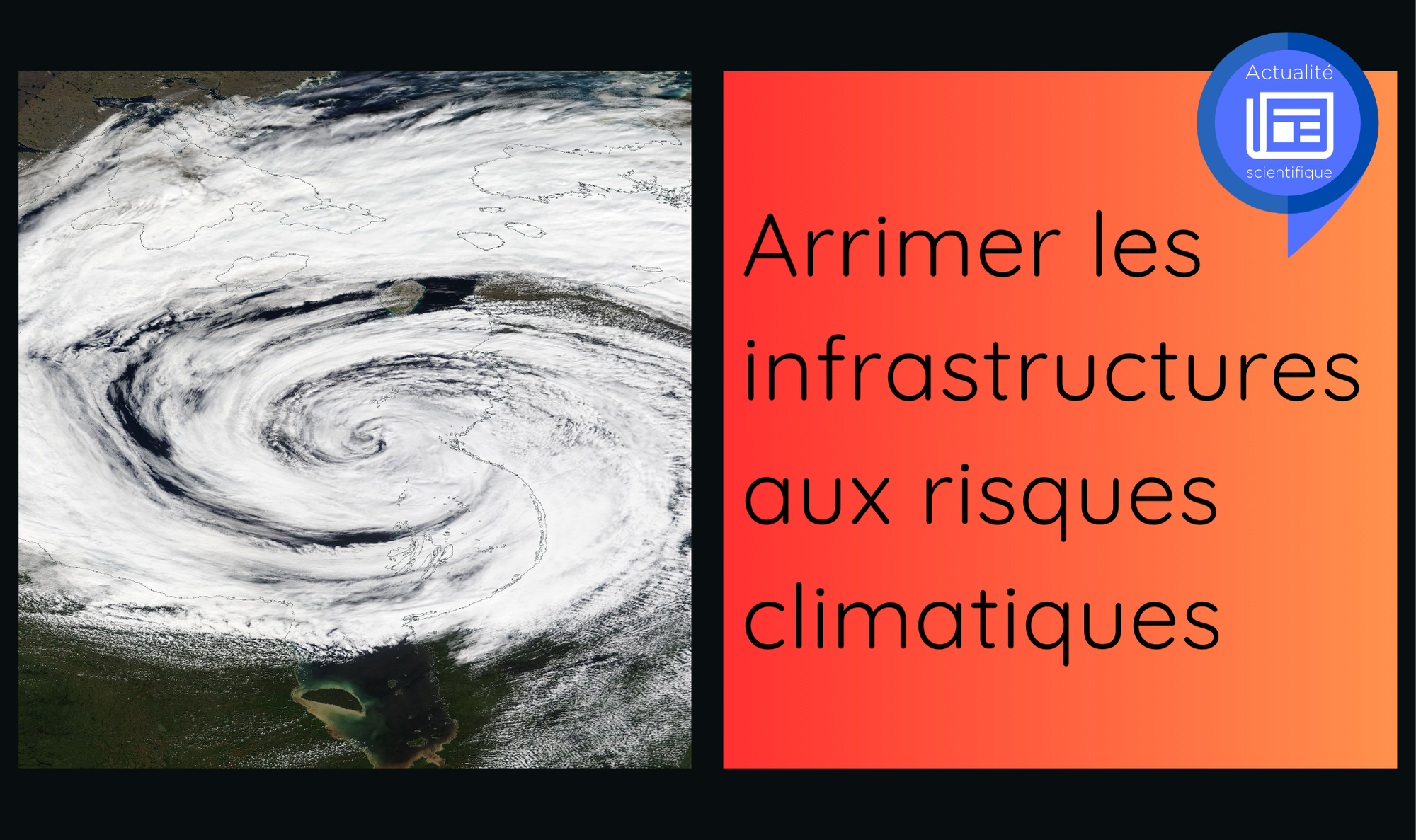
Un article de Valérie Levée, journaliste scientifique
Le gouvernement du Québec compte sur l’hydroélectricité et l’exploitation de minéraux critiques pour la transition énergétique et la décarbonation du Québec. Sauf que les infrastructures minières et hydroélectriques sont elles-mêmes soumises aux aléas climatiques. D’où le projet ARRIMÉ (Aléas, Risques et Résilience des Infrastructures Minières et Électriques du Québec) initié pour comprendre et prévenir les risques associés aux précipitations, crues et vents intenses; un projet dirigé par Philippe Gachon, professeur au Département de géographie de l’UQAM.
Janvier 1998, une tempête de verglas plonge dans le noir plus de 3 millions de Québécois. La « crise du verglas » qui s’ensuivit reste gravée dans les mémoires, mais la majeure partie des coupures d’électricité est causée par des rafales de vent et des arbres qui s’abattent sur les fils électriques. Et ces coups de vent, Hydro-Québec ne les voit pas venir faute de précisions suffisantes des modèles météorologiques utilisés par Environnement Canada. Hydro-Québec n’a pas non plus accès à une bonne prévisibilité des pluies intenses et des crues subites qui pourraient menacer ses infrastructures construites dans les années 60 quand les changements climatiques n’étaient pas encore un sujet de préoccupations. Décembre 2023, les résidents de Chute Saint-Philippe doivent évacuer d’urgence, car des faiblesses ont été repérées dans la digue Morier en amont du village. Le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), propriétaire de cette digue, craint aussi l’effet des changements climatiques sur ses propres ouvrages. Quant à l’industrie minière, elle aussi s’inquiète des pluies intenses parce que les parcs de résidus miniers n’ont pas été conçus en fonction des changements climatiques. Si l’eau des précipitations n’est pas contenue dans les parcs, les débordements pourraient contaminer l’environnement.
Raffiner les modèles
Les modèles météorologiques et climatiques utilisés par Environnement Canada manquent encore de précision pour dire où, quand et avec quelle force frapperont les rafales ou les précipitations intenses et les crues subites qui en découleront. Même s’ils se sont raffinés au cours des ans, leur résolution de 10 km utilisée pour la prévision à moyenne ou à longue échéance ne permet pas de tenir compte des caractéristiques locales de terrain. Or si la météorologie dépend de la circulation des masses d’air, elle est aussi affectée par les interactions avec la surface. Par exemple, les vallées influencent le régime de vent, une montagne reçoit plus de précipitations qu’un terrain plat, le couvert végétal affecte la température, le taux d’humidité et les vents...
« Plus on affine le modèle, plus on est capable de capturer des effets régionaux voire locaux, et de tenir compte des échanges d’eau et d’énergie entre la surface et l’atmosphère. Et plus le climat se réchauffe, plus ces échanges à fine échelle sont importants », explique Philippe Gachon.
C’est pourquoi Hydro-Québec est allé quérir l’expertise du Centre pour l’étude et la simulation du climat à l’échelle régionale (ESCER) pour initier le projet ARRIMÉ.
« Hydro-Québec voulait une meilleure information à l’échelle de leurs bassins versants sur les précipitations maximales probables qui peuvent engendrer des crues et affecter leurs infrastructures et savait qu’ESCER développait un modèle régional du climat à très haute résolution », poursuit Philippe Gachon. Le MELCCFP et l’industrie minière se sont aussi joints au projet.
Sous la loupe de la haute résolution
Les modèles développés par ESCER ont une résolution de 2,5 km et à cette échelle, ils voient ce que les modèles précédents n’ont jamais vu et notamment que le nord du Québec est soumis à une très forte variabilité météorologique. La vaste étendue d’eau de la Baie d’Hudson génère des tempêtes et des vents très intenses. « C’est comme des petits systèmes cycloniques, on peut voir un œil dans ces systèmes », décrit Philippe Gachon. Or les changements climatiques modifient le couvert de glace et les conditions changeantes à la surface de la mer affectent les tempêtes qui pourraient se faire plus fréquentes à certaines périodes de l’année. Sur la terre ferme, les vents eux-mêmes varient en fonction du relief et de la végétation. Au nord, là où la taïga fait place à la toundra, les vents sont plus intenses. L’échelle des modèles développés par ESCER permet aussi de tenir compte des phénomènes de convection des cellules orageuses et révèle des précipitations et des vents plus intenses que les modèles à basse résolution. La précision spatiale apporte aussi une précision temporelle car les modèles à haute résolution voient le développement des cellules orageuses au cours de la journée, et reproduit mieux le cycle diurne de précipitations associé.
Revoir les infrastructures
Cette meilleure prévisibilité spatiale et temporelle doit permettre de mieux appréhender les risques posés par les précipitations et les vents intenses sur les infrastructures hydroélectriques et minières. Comme c’est la combinaison des vents et des pluies intenses qui menacent le plus les infrastructures, ESCER poursuit sa recherche pour repérer les tempêtes qui génèrent cette combinaison d’aléas. Dans la suite du projet, les ingénieurs pourront s’emparer de ces informations pour adapter les infrastructures existantes et mieux concevoir celles de demain. Il pourrait s’agir de revoir le dimensionnement des digues, d’ajuster les évacuateurs de crues, d’augmenter la capacité de stockage de l’eau en amont, d’enfouir les lignes électriques les plus vulnérables...
Pour aller plus loin
Benoit, C., Demers, I., Roberge, F., Gachon, P. et Laprise, R. (2022). Inondations des printemps 2017 et 2019 dans le bassin versant de la rivière des Outaouais (Québec, Canada) : analyse des facteurs physiographiques et météorologiques en cause. Dans T. Buffin-Bélanger, D. Maltais et M. Mario Gauthier (Eds.), Les inondations au Québec : risques, aménagement du territoire, impacts socioéconomiques et transformation des vulnérabilités (pp. 29-58). Presses de l’Université du Québec.
Llerena, A., Gachon, P. et Laprise, R. (2023). Precipitation Extremes and Their Links with Regional and Local Temperatures: A Case Study over the Ottawa River Basin, Canada. Atmosphere, 14(7), article 1130. https://dx.doi.org/10.3390/atmos14071130
Moreno-Ibáñez, M., Laprise, R. et Gachon, P. (2023). Analysis of the Development Mechanisms of a Polar Low over the Norwegian Sea Simulated with the Canadian Regional Climate Model. Atmosphere, 14(6), article 998. https://dx.doi.org/10.3390/atmos14060998
Moreno-Ibáñez, M., Laprise, R. et Gachon, P. (2023). Assessment of simulations of a polar low with the Canadian Regional Climate Model. PLoS ONE, 18(10), article e0292250. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0292250
Roberge, F., Di Luca, A., Laprise, R., Lucas-Picher, P., Thériault, J. (2024). Spatial spin-up of precipitation in limited-area convection-permitting simulations over North America using the CRCM6/GEM5.0 model. Geoscientific Model Development, 17(4), 1497-1510. https://doi.org/10.5194/gmd-17-1497-2024
Retour aux actualités

